Frédéric Cossutta
(cossutta.frederic@orange.fr)Né en 1949, est un philosophe français spécialisé dans l’étude des dimensions discursives de la philosophie envisagée dans ses pratiques et dans ses textes. Il a fondé une méthode d’analyse du discours philosophique qui, tout en permettant d’objectiver les formes d’exercice et d’écriture de la philosophie, ne rompt pas avec la possibilité de mettre en œuvre une imagination spéculative au service d’un renouveau philosophique. Il anime le « Groupe de recherche sur l’analyse du discours philosophique » (gradphi.hypotheses.org) et dirige des collections de philosophie, d’abord aux éditions Lambert-Lucas et, depuis 2024, aux éditions Vrin. (listes des publications provisoirement sur le site didac-philo.com)

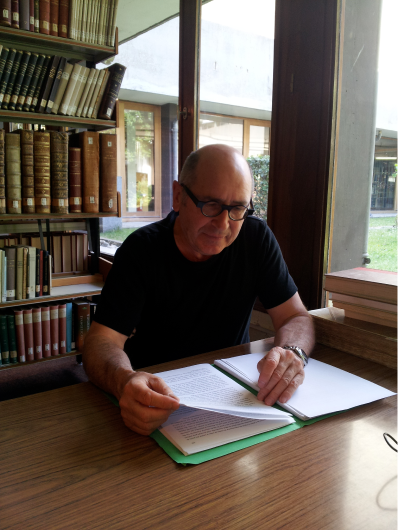
TRAJET DE VIE, TRAJET DE PENSEE
UNE CERTAINE INSCRIPTION AUTOBIOGRAPHIQUE…
Je suis né le 19 mai 1949 à Milly la Forêt (91) et, après la fin de mon activité professionnelle je suis revenu m’installer au cœur de la forêt de Fontainebleau qui a toujours constitué le point d’ancrage de mon imaginaire et de ma généalogie familiale, entre dépaysement et enracinement dans la singularité d’un lieu. Mes grands-parents et oncles, bucherons d’un côté, paysans pauvres immigrés depuis le nord de l’Italie de l’autre qui sont venus y travailler dur comme carriers, tout en rêvant pour leurs enfants d’une promotion par l’Ecole de la République et d’un accès aux valeurs de la culture. Ce lien entre un attachement à la matière que l’on transforme par le travail et à des valeurs de solidarité et d’accès à l’art et à la poésie a constitué une ligne de force pour un dessein de vie qui a toujours associé l’activité intellectuelle et l’engagement à vivre intensément la relation avec le monde et avec les autres. Ma vocation philosophique est née très tôt de cette soif de comprendre, de savoir, au-delà de ce que les savoirs positifs pouvaient lui apporter, de transmettre aussi, d’expliquer de faire comprendre. Elle s’est traduite par deux orientations conduites simultanément tout au long de ma vie et de mon parcours professionnel : l’enseignement de la philosophie et une activité de chercheur.
UNE VIE PROFESSIONNELLE TOUT ENTIERE D’ENSEIGNANT-« TOUT TERRAIN »
Après deux années en classe préparatoire au Lycée Henri IV et dans le cadre de l’Ecole Normale Supérieure de St. Cloud (1970-75) j’ai poursuivi un double cursus, en philosophie (DEA et thèse d’Etat sous la direction de J.T. Desanti) et en lettres-linguistique (cursus de lettre modernes à Paris 7 et DEA de linguistique sous la direction d’Antoine Culioli). Après l’obtention de l’Agrégation de philosophie commence une longue carrière de professeur enthousiaste dans toutes les classes du secondaire, en Lycée général et technique, en particulier au Lycée de Sens de 1978 à 1998. L’Inspection Générale de philosophie n’ayant pas apprécié le livre où je proposais une méthodologie de la lecture des textes philosophiques (Eléments pour la lecture des textes philosophiques, Bordas 1989) je n’obtins de classe préparatoire aux grandes écoles qu’en 1998, et, pour avoir accepté un détachement de deux ans au CNRS, je fus réintégré (provisoirement) dans le secondaire en Lycée technologique industriel.
Tout en pratiquant une pédagogie classique animée par le souci éthique et politique de formation de mes élèves pour le baccalauréat ou les concours, mon souci concernant la formation à l’argumentation et à la lecture des textes m’a conduit à prêter la plus grande attention à la formation des professeurs et aux outils dont ils ont besoin dans l’exercice de leur profession. Certains de mes travaux de recherche ont inspiré des exercices pour la classe et, soucieux d’offrir à mes collègues des outils didactiques ou des ouvrages théoriques ou historiques, j’ai écrit deux livres à portée didactique (outre le livre déjà cité de 1989, j’ai proposé pour les classes de terminale : L’explication de texte philosophique au Baccalauréat, Paris, Colin, 2006 et créé une collection de livres entièrement dédiés à l’enseignement de la philosophie (Didac-philo.com)
UNE FORMATION PHILOSOPHIQUE DANS LES ANNEES 70-80
Parallèlement à mes études de philosophie à l’ENS de St. Cloud et à Paris I Sorbonne, comme étudiant puis thésard de J.T. Desanti, j’acquiers une formation en linguistique sous la direction d’Antoine Culioli à Paris VII et je m’initie aux théories de l’énonciation. Les cours de Jacques Bouveresse et la rédaction d’un mémoire de maîtrise sur The concept of mind de G. Ryle me permettent de me familiariser avec la philosophie anglo-saxonne qui ne m’intéresse que dans la mesure où elle propose des protocoles d’analyse des énoncés philosophiques, indexés sur le langage logique ou au contraire sur le langage ordinaire. La lecture précoce du livre de Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique (Editions augustiniennes 1987) lorsque j’étais en classe préparatoire à HIV, me fait prendre conscience de la dimension pragmatique et transformatrice de soi de la philosophie. La rencontre déterminante avec Sur la logique et la théorie de la science de Cavaillès et les cours de Jean-Toussaint Desanti sur Husserl me détournèrent des sirènes heideggériennes ou derridiennes (concernant la façon dont je me situe par rapport aux conceptions de la philosophie par Desanti (voir Cossutta 2017a). La lecture du Foucault de L’archéologie du savoir contribue à ce que je me démarque d’Althusser et des tentatives marxisantes d’analyse du discours dans le sillage de Michel Pêcheux (j’ai fréquenté le laboratoire de lexicologie politique de l’ENS de St. Cloud en compagnie de Dominique Maingueneau sans pouvoir nous satisfaire de cette approche lexicologique, ce qui nous a déterminé à inventer nos propres outils d’analyse. Ces lectures ainsi que l’histoire de la philosophie pratiquée par Martial Gueroult, comme celle qu’applique Victor Goldschmit aux dialogues de Platon, la fréquentation des ouvrages de Vuillemin et Granger me confortent dans une certaine conception qui privilégie l’importance accordée aux structures et aux dynamiques immanentes sur les continuités historiques. Peu à peu se forme l’idée que pour tenter de comprendre ce que c’est que penser, il faut s’intéresser aux constituants langagiers et institutionnels de l’activité pensante et en particulier à celle de la philosophique, sans la réduire aux monuments purement textuels où la figent le panthéon des « grandes œuvres ». Cela m’encourage, après le détour transitoire par la philosophie analytique, à suivre un cursus de littérature puis de linguistique dans le sillage des théories subtiles développées par le modèle culiolien.
Il y a de la philosophie « entre les œuvres » et les textes mineurs ou seconds qui contribuent à son apprentissage et à sa transmission constituent un ensemble d’activités et de textes qui en formatent l’exercice. Comment penser cette activité philosophique sans la dissocier de l’étude des textes et des œuvres comme le fait la sociologie ? Quelles dimensions langagières privilégier pour rendre compte non seulement des philosophèmes mais de l’activité qui les pose. Répondre à cette interrogation pose la question préjudicielle de l’utilisation des sciences du langage pour aborder la philosophie qui est toujours rebelle à se voir appréhender par des disciplines extérieures à elle puisqu’elle se fait fort, inversement, de penser les autres types de discours. C’est à la résolution de cette question préjudicielle et au risque d’aporie qu’elle suscite que je me suis attelé dans un premier temps. (« Pour une analyse du discours philosophique »)
UNE ACTIVITE DE CHERCHEUR FONDATEUR D’UN CHAMP DISCIPLINAIRE ORIGINAL : L’ANALYSE DU DISCOURS PHILOSOPHIQUE
Préalables épistémologiques et philosophiques
Une tentative pour résoudre la série des paradoxes épistémologiques et philosophiques posés par ce projet constitue le préalable théorique et le fondement de ce qui m’amena à proposer l’élaboration d’un champ disciplinaire nouveau : l’analyse du discours philosophique.
L’explicitation des conditions de possibilité tant d’un point de vue philosophique qu’épistémologique d’un tel projet a exigé l’investigation des raisons principielles de son impossibilité et une tentative pour surmonter les apories qui le grevaient par principe. Avec la nécessité de se situer par rapport aux voies herméneutique (Ricoeur) ou déconstructrice (Derrida) renvoyées dos à dos : « si Ricoeur, alors Derrida, si Derrida, alors Ricoeur ». Ces analyses préalables ont été développées dans une Thèse d’Etat ancienne formule sur travaux dirigée par J.T. Desanti intitulée : Problèmes de méthode dans l’analyse des textes philosophiques, et d’abord condensée dans un texte proposé pour l’obtention d’une direction de programme au Collège International de Philosophie (texte inédit dont on trouve une certaine trace dans Cossutta 1995b (fichier bibliographie)
Ces apories une fois réduites, Il devenait possible d’appréhender la philosophie (textuelle ou orale) en tant que discours, en utilisant les catégories et les méthodes développées par l’Analyse du Discours telles qu’elles se sont développées, notamment en France depuis les années 80, sans cependant tomber dans une approche positiviste ou réductrice du philosophique. Le projet d’une objectivation des formes ou des moyens expressifs utilisés par les philosophes ne devait conduire ni aux écueils d’un textualisme ni à à celles d’un formalisme. La catégorie de « discours », englobant la textualité et les activités ainsi que les cadres institutionnels où la philosophie prend place, permettait d’éviter la réduction de la philosophie à ses textes en oubliant qu’ils sont inscrits dans des pratiques contraintes ou « cadrées » par des institutions. Le souci de toujours rapporter l’étude des formes et des opérations linguistiques au substrat doctrinal, aux schèmes spéculatifs qu’elles formatent permettait, de son côté, d’éviter le risque d’un formalisme qui se serait contenté de relever des traits stylistiques ou rhétoriques sans les rapporter à l’effort d’une pensée qui se fraye un chemin dans la langue et dans l’écriture pour s’ériger en doctrine ou en système.
Le refus de la spécialisation et le choix d’explorer une diversité de philosophies et de mécanismes discursifs
Un choix crucial s’est alors imposé à moi, avec ses conséquences négatives du point de vue d’une « carrière » universitaire : il n’était pas question de s’enfermer dans l’étude d’une philosophie particulière, d’une doctrine ou d’un époque et de devenir un spécialiste mais au contraire de multiplier les perspectives et les études singulières afin de tenter de mettre en évidence certaines des grandes contraintes et des régularités qui structurent la philosophie envisagée comme discours. Et cela sans sacrifier à la rigueur ni aux acquis de l’histoire de la philosophie, avec l’impératif de toujours tenter de nouer des relations constructives avec les spécialistes. (Ce qui a été souvent le cas, avec ce paradoxe apparent que, contrairement à l’opinion négative de nombre de collègues, de nombreux spécialistes attachés à un auteur ou un courant de pensée ont souvent accepté une collaboration sur des programmes précis)
J’ai ainsi tenté de mettre en évidence certaines propriétés générales en explicitant quelques grandes contraintes discursives du philosophique. Certes il n’y a pas de philosophia perennis en un sens abstrait qui supposerait une essence de la philosophie et pourtant ce qu’on appelle philosophie, ou ce qui se réclame d’elle, suppose une certaine pérennité historique depuis l’antiquité malgré les déplacements de frontière des divers champs disciplinaires. Cette continuité d’inspiration, sous la diversité des définitions est tracée et réfléchie par la discipline elle-même qui ainsi s’auto-perpétue sous la multiplicité de ses métamorphoses. J’ai ainsi été amené à caractériser, avec Dominique Maingueneau (Cossutta 1995a) la philosophie comme « discours constituant » et, en la comparant avec les discours de fiction, les discours littéraires (Cossutta 2004)), religieux, scientifiques, comme discours « auto-constituant » (Cossutta 2015a, 2025)
Progressivement, j’ai entrepris d’explorer les contraintes internes au discours philosophique lui-même : caractéristiques énonciatives de la scène philosophique, modes de validation des énoncés et des thèses par l’argumentation, ajustements des cadres génériques en fonction de modalités doctrinales spécifiques (l’expositions more geometrico convient parfaitement à la métaphysique spinoziste, pas du tout à la métaphysique cartésienne qui privilégie un tempo méditatif) Le choix des genres textuels peut aussi obéir à des modes d’investissement par lesquels un philosophe cherche à s’imposer dans le champ, comme l’indiquent les nombreuses tentatives faites par Descartes pour ré-exposer sa métaphysique (Cossutta 1996). Ont fait l’objet d’investigation : l’étude de genres textuels notamment du genre dialogue, rôle des fictions, du biographique, formes de transmission par détachement de formules, formation des œuvres au croisement des corpus et des doctrines etc. Cela tout en ayant toujours soin de conduire une étude précise de fragments de textes ou d’ouvrages complets hérités de la tradition (Platon, Sceptiques, Descartes, Leibniz, Hume, Kierkegaard, Bergson, Wittgenstein Levinas, Derrida) avec pour souci que l’analyse permette un gain d’intelligibilité de leur teneur philosophique. (Pour avoir un aperçu des mécanismes explorés, des auteurs et des œuvres (voir la liste de Publications)
On peut se rendre compte du chemin parcouru entre la mise en chantier de ce programme dans les années 70 jusqu’à aujourd’hui en comparant deux textes de référence :
-le texte programmatique et qui eut valeur de manifeste dans un numéro de la revue Langages n° 119 de 1995 : « Pour une analyse du discours philosophique ».(p. 12-39). L’ensemble du numéro était consacré à L’Analyse du discours philosophique (Liens vers le texte n° 1).
-Un texte rédigé avec Dominique Maingueneau en 2019 qui fait le point sur ce travail de très longue haleine : « L’analyse du discours philosophique, bilan et perspectives », qui sert d’introduction dans Cossutta Frédéric et Dominique Maingueneau (éds), L’analyse du discours philosophique, Analyse du discours et argumentation, n°22 (Lien vers texte n° 2). Ce texte propose une mise en perspective et un bilan qui atteste de la rigueur et de l’opiniâtreté avec laquelle le projet esquissé à titre programmatique dans le numéro de langage de 1995 a été effectivement mis en œuvre. (voir aussi la Bibliographie analytique proposée dans ce même volume qui propose une liste d’articles et de livres consacrés à ce type d’investigation). Il témoigne aussi de la fécondité de cette investigation qui, entretemps a pris une dimension collective (voir plus loin)
Les risques d’une approche métaphilosophique et positiviste qui couperait les ponts avec la philosophie
Le choix d’un détour par l’objectivation des formes et des pratiques qui a requis de mobiliser des outils issus des sciences du langage, ajouté au refus de s’enfermer dans l’étude d’une époque ou d’une philosophie particulière n’a pas été vraiment compris par la communauté des
philosophes.
Pourtant ce programme ne coupe nullement les ponts avec la philosophie, ni avec l’histoire de la philosophie ni avec la spéculation philosophique. En effet en approfondissant les aspects philosophiques sous-jacents à ce mode d’investigation j’ai été conduit à instaurer un dispositif théorique à même d’établir une liaison entre la philosophie comme discours observé et la philosophie comme discours d’investigation, entre l’analyse du discours philosophique comme discours analysant et l’analyse du discours comme objet d’une réflexion épistémologique. Comment penser ces relations complexes sans se contenter de soumettre un champ à la domination de l’autre ni sans inversement les confondre comme le fait Derrida en brouillant les limites entre texte commenté et texte de commentaire ?
Par ailleurs ce programme de recherche peut se targuer d’une certaine fécondité, tant du point de vue de l’histoire de la philosophie que pour le regard décalé et renouvelé qu’il permet d’apporter sur cette discipline.
En premier lieu ce type d’approche permet des interventions dans le cadre de l’étude des doctrines ou de l’histoire de la philosophie. Ainsi par exemple, en analysant la façon dont Descartes élabore la mise en scène et la distribution des rôles dans sa tentative de dialogue philosophique j’ai pu proposer une hypothèse pour répondre à la question non résolue de son inachèvement. Une attention portée aux protocoles conversationnels par lesquels les personnages discutent de leur façon d’interagir comme on les observe constamment dans les dialogues de Platon permet d’affiner la compréhension des dispositifs dialogiques et de la façon dont ils contribuent à une recherche philosophique en mouvement dialectique (Cossutta 1997b et 2001a, 2001b, 2004g et Publications). Expliciter les modes de constitution de la conceptualité sartrienne et le rôle des images dans L’être et le néant offre un éclairage neuf sur l’élaboration de son ontologie (Cossutta 2021).
Analyser le rôle que jouent les formules qui essaiment dans l’interdiscours philosophique ou dans l’espace public comme l’étendard d’une philosophie, (Cossutta 2004e, 2014) s’intéresser aux dimensions auto-biographiques de l’écriture des philosophes (Cossutta 2012, 2020b), mettre en relation les formes d’écriture et les conditions institutionnelles d’exercice de la philosophie, autant de façon de déplacer le regard pour considérer la philosophie non comme un panthéon figé de grandes œuvres mais comme l’espace vivant d’une activité aux multiples facettes. Ce type d’approche déplace notre regard sur la philosophie puisqu’on ne sépare pas le texte de son contexte, on ne les réduit pas non plus l’un à l’autre mais on tente de proposer une relation en boucle entre l’un et l’autre (voir la catégorie de scénographie élaborée par Dominique Maingueneau, par exemple dans La philosophie comme institution discursive, Limoges, Lambert-Lucas, 2015(site Didac-philo.com, col « Le discours philosophique »), On se préoccupe des usages qui sont faits de ces textes, on s’intéresse à leur diversité fonctionnelle et de genre textuel, à l’interdiscours qui les relie ou les dissocie d’autres formes de discours comme les discours littéraires, scientifiques ou religieux.
En second lieu, la dimension métaphilosophique de l’Analyse du discours philosophique n’est pas une posture en surplomb car, en renouvelant notre approche des grandes philosophies traditionnelles, elle favorise l’innovation interprétative et l’audace philosophique. La dimension descriptive n’anéantit pas l’intérêt pour la philosophie ni l’effort pour philosopher mais en renouvelle la possibilité en redonnant sa place à ce qu’on pourrait appeler la fiction spéculative. L’investigation est plus descriptive que normative. Il ne s’agit pas de prétendre rectifier les « erreurs d’assignation catégoriales » (Ryle) des philosophies comme prétendirent le faire le positivisme logique tout comme les philosophies du langage ordinaire. Le temps d’objectivation des propriétés langagières de la philosophie peut offrir l’opportunité d’un moment interprétatif ou spéculatif : en mettant en évidence les constituants discursifs du philosophique, on bénéficie de la possibilité de reprendre à nouveaux frais certains problèmes ontologiques, épistémique ou éthiques et cela, tantôt de façon critique, tantôt de façon positive. Ainsi par exemple, une attention prêtée aux règles dialogiques et contrats conversationnels qui président au déroulement d’un dialogue platonicien, permet de reconsidérer certains aspects des Ethiques du Discours comme celles de Habermas ou Apel (cf. Cossutta 2003a), L’étude des procédés utilisés par les sceptiques grecs autorise une critique des grandes tentatives refondationnelles, comme les pragmatiques transcendantales, ou de proposer les linéaments d’une éthique pour temps de crise.
L’ensemble de cette approche repose sur certains présupposés méthodologiques qui ne sont pas sans reposer eux-mêmes sur certaines options philosophiques, certes à caractère paradoxal. En effet, l’investigation objectivante des formes du discours philosophique suppose une suspension préalable au moins provisoire des prétentions à la vérité des systèmes de pensée. Les sceptiques avaient déjà procédé à une telle suspension critique en « désossant » les dispositifs argumentatifs des philosophies qu’ils examinaient, sur un mode critique certes, mais qui supposait une description précise des mécanismes de validation d’un système de pensée (Cossutta 1994).
Ainsi le recours aux tropes sceptiques comme outil d’investigation et à la suspension de la prétention à la vérité des doctrines ne signifient en rien la mise à mort de la philosophie. On peut même aller plus loin en affirmant que la réhabilitation du scepticisme antique, non seulement comme une philosophie parmi d’autres mais comme un éléments constitutif de l’exercice même du philosopher, qui doit se confronter au risque de sa propre impossibilité, ouvre des horizons philosophiques insoupçonnés (pour une explicitation du rôle jouée par un recours aux tropes sceptiques dans l’analyse du discours philosophique voir le texte inédit présent sur ce site « L’Analyse du discours philosophique, entre analyse du discours et philosophie »(texte 3 inédit) . Ainsi j’ai fait jouer simultanément au scepticisme antique réhabilité -un rôle critique de réduction de certaines prétentions philosophiques exorbitantes (les entreprises de refondation métaphysique déjà mentionnées comme celle de la pragmatique transcendantale de K. O Apel) -un rôle spéculatif créatif dans l’élaboration d’une extatique ou d’une ontologie de l’apparaître (cf. « mystique et scepticisme » Cossutta 2018)
Si bien qu’au lieu d’une lutte pour l’hégémonie de la part de l’analyse du discours sur la philosophie ou de la philosophie sur les autres formes de discours, il faut considérer une relation en boucle paradoxale où morts et renaissances s’enchaînent sans fin. La relation entre discours analysant et discours analysé est en effet particulière puisque la relation de dépendance est réversible : l’analyse du discours philosophique est dans une relation paradoxale en boucle avec la philosophie (voir l’inédit susmentionné, partie sections 5 et 6). Il ne s’agit pas de reconduire le thème d’une mort de la philosophie ni non plus de renoncer à philosopher, mais de faire basculer la philosophie du côté d’une fiction qui se nie comme telle mais offre par sa créativité exploratoire des modèle possibles d’intelligibilité du monde et de compréhension de soi.
Mes activités professionnelles d’enseignant et la mise en œuvre de ce programme de recherche assez technique de caractère métaphilosophique, à la fois individuel et collectif, ont accaparé mon temps au point que la partie directement philosophique de mon travail, qui relève d’une imagination spéculative, celle-là-même qui est à l’origine de la surabondance créatrice des œuvres de philosophie, a donné lieu à peu de publications et reste un horizon d’exploration pour le libre jeu de ce que j’aimerais appeler des fictions spéculatives.
Les conditions institutionnelles de mise en œuvre de ce programme et son élargissement vers une dimension collective et éditoriale
*Création d’un groupe de travail : Groupe de recherche sur l’analyse du discours philosophique
Il ne m’a pas été donné de réunir les conditions optimales pour donner à ce programme de recherche une assise institutionnelle qui lui aurait permis de s’ancrer dans un centre de recherche universitaire car les institutions philosophiques n’ont pas compris la nature de ce travail. Pourtant je me suis obstiné, en marge de mon travail de professeur en classe de terminale puis de khâgne, à conduire à bien ce projet de recherche en marge et dans une relative indifférence générale, sauf avec la bienveillance des spécialistes en Analyse du discours pour lesquels mon approche avait l’intérêt d’intégrer au champ disciplinaire le discours philosophique.
L’obtention d’une Direction de Programme au Collège International de Philosophie a été une chance inespérée (1992-1997). En me déchargeant d’une partie de mes tâches d’enseignant pendant six ans elle m’a permis de conduire à son terme ma thèse d’état, de commencer à publier et d’élaborer une méthode et des catégories d’analyse. Un détachement au CNRS pendant deux ans (UMR Savoirs et Textes, Lille, 2000-2003 avec l’attention bienveillante de Pierre Macherey) m’a permis de parfaire ma formation de chercheur dans un cadre très stimulant. Enfin le CEDITEC (lien vers le site du CEDITEC Université Paris-est Val de marne) m’a accueilli dans l’axe « analyse du discours » piloté par Dominique Maingueneau et m’a offert un lieu de discussion et des aides à la recherche très précieux dont je lui suis infiniment reconnaissant.
Ce programme de recherche, commencé dans un certain isolement a cependant pris progressivement une dimension collective. En effet j’ai fondé en 1993 un groupe de recherche au sein du Collège International de philosophie intitulé Groupe de recherche sur l’analyse du discours philosophique, puis, une fois ma direction de programme terminée, je l’ai animé sans interruption jusqu’à ce jour (voir le blog en ligne : gradphi.hypotheses.org).
Il m’a semblé opportun en effet de regrouper sans exclusive des chercheurs eux aussi intéressés par l’appréhension de la philosophie sous son angle discursif ou langagier sans exclusive d’obédience. Composé de philosophes, d’historiens de la philosophie, de spécialistes en sciences du langage (linguistique, sémiotique, analyse du discours, stylistique), ce travail collectif a donné une ampleur et une dimension publique à des travaux dont les résultats constants et nombreux ont été partagés sous forme de journées d’études, de colloques et de publications (Liste des Publications collectives du gradphi). Ce groupe de recherche se réunit en séminaire fermé (entre 7 et 15 membres selon les périodes avec un noyau stable depuis l’origine) une fois par mois sans discontinuer depuis maintenant 30 ans. Les thèmes abordés peuvent occuper une ou plusieurs années de travail et nous avons couvert peu à peu bon nombre d’entrées thématiques d’un programme d’analyse du discours philosophiques, en veillant toujours à nous appuyer sur une certaine diversité d’auteurs comme point d’appui de nos investigations (le tableau présentant les activités du gradphi depuis 1993). Depuis 1997 le groupe a été accueilli à l’Université Paris III par Francine Cicurel et a fait partie de l’Equipe du CEDITEC. Depuis, il continue son travail, accueilli par Pascale Delormas et Mathilde Valespir à la maison de la recherche de Sorbonne- Université. De nombreuses collaborations ont été nouées avec des équipes nationales ou européennes, des journées d’études et des colloques ont été organisés autour des thèmes abordés, avec le souci d’ouvrir l’investigation à des chercheurs venus d’autres horizons ou appartenant à d’autres courants ou écoles.
Ce groupe se caractérise par sa vocation interdisciplinaire, par le refus des exclusives méthodologiques, par l’attention données aux productions effectives (textuelles ou orales) des philosophes en prenant en considération leur conditions de mise en œuvre, par son souci de s’élargir par des collaborations régulières avec d’autres chercheurs et par son souci de mettre ses travaux à l’épreuve de la discussion par des publications régulières (une dizaine de collectifs à ce jour)
*Création en 2013 d’une collection de livres dédiés aux aspects formels ou institutionnels de la philosophie : « Le discours philosophique »
Cet élargissement a pu prendre une assise plus conséquente grâce à la création chez l’éditeur spécialisé en sciences du langage Lambert-Lucas d’une collection intitulée « Le discours philosophique » qui a accueilli des ouvrages originaux venant d’horizons différents de ceux
du groupe de recherche (liste des Parutions dans la collection « Le discours philosophique »). Collection ouverte à des études de genre ou formes de pensée (sur le statut de la diatribe, des formes médiévales de disputatio, énoncés formulaires), ou sur l’analyse d’opérateurs jouant sur la construction d’une philosophie, métaphores, concepts et sur l’ensemble des aspects de la philosophie que l’on pourrait qualifier de formels, textuels, institutionnels.
La disparité des inspirations méthodologiques des auteurs, loin d’être un obstacle est un facteur d’enrichissement puisque sont ainsi étudiés des phénomènes textuels ou discursifs très divers, parfois très spécialisés comme dans le livre dédié à la forme diatribe dans l’antiquité ou celui qui analyse le statut des métaphores chez Leibniz, ou beaucoup plus généraux, par exemple dans le collectif sur la production des concepts en philosophie (Cossutta 2020) ou sur la dimension sémiotique ou institutionnelle de la philosophie (Bordron 2016).
*Création en 2021 d’une collection dédiée aux rapports entre philosophie et langage : Collection « Philosophie et langage » ( liste des publications et Didac.philo.com, onglet « Philosophie et langage »)
En cohérence avec la vocation première des éditions Lambert-Lucas, importante maison d’édition en sciences du langage, j’ai voulu donner la parole -à des philosophes à même d’apporter des textes théoriques traitant des questions du langage -à des spécialistes en sciences du langage qui, au-delà de l’aspect directement technique de leur discipline, ont une réflexion de portée générale sur le langage, la communication. Une façon de créer une synergie interdisciplinaire.
*Création en 2018 d’une collection dédiée à l’enseignement de la philosophie : Didac-philo (liste des publications et didac-philo.com). D’abord chez l’éditeur Lambert-Lucas et désormais aux éditions Vrin
J’ai précisé que, longtemps professeur dans l’enseignement secondaire, j’avais été frappé par le manque de moyens dédiés à une réflexion sur la didactique de la discipline ou sur les conditions historiques et institutionnelles de son enseignement. Ce n’est plus tout à fait le cas et les formations permanentes, les sites académiques ont enrichi la réflexion et les outils en vue d’une didactique de la philosophie, jusque et y compris sur les conditions de possibilité d’un tel exercice. Les polémiques se sont atténuées et on peut espérer un effort de compréhension réciproque de la part des différents courants qui s’affirment sur ces questions. J’ai précisé aussi que certains de mes travaux avaient été utilisés pour mettre au point des exercices pour la classe, notamment concernant les méthodes de lecture des textes philosophiques. Enfin j’ai fait allusion à la rédaction de deux manuels dont le premier m’avait valu pas mal d’ennuis auprès de l’inspection générale de l’époque1 (Cossutta 1994 et 2006).
Lorsque Marc Arabyan, le directeur éditorial de Lambert-Lucas, m’a donné carte blanche pour créer une collection entièrement consacrée à l’enseignement de la philosophie, j’ai cru pouvoir rendre justice à ce vœu ancien d’aider les collègues en poste à réfléchir sur leur pratique, à trouver des outils théoriques et pratiques. En dépit des clivages assez forts qui divisent la profession, il m’a semblé évident de ne pas faire de cette collection l’expression d’un courant ou d’un autre et de l’ouvrir à toutes les obédiences qui se partagent la réflexion sur la didactique de la philosophie. En complément de ces ouvrages j’ai mis en place une série annexe portant sur les Notions mises aux concours de l’agrégation et qui recoupent les programmes de classe terminale. Ils sont ainsi à la fois utiles aux étudiants avancés qui passent les concours et aux professeurs en exercice qu’ils aident à enrichir leurs cours. Cette collection est à présent prolongée sous la même identité et dans le même esprit aux éditions Vrin (site de Vrin, /collection/ Didac-philo).
- L’évaluation laudative qu’en avait fait Deleuze dans une note finale de l’introduction de Qu’est-ce que la philosophie ? associée à un petit mot personnel où il me reconnaissait des véritables qualités de philosophe m’avait largement consolé de cette incompréhension. ↩︎